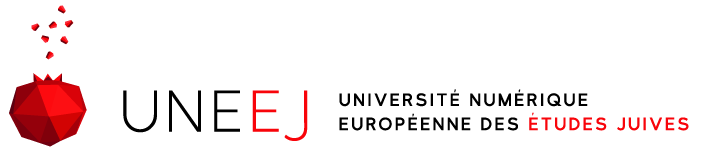Bible et archéologie : une histoire passionnée et le renouveau d'un dialogue rompu
Ce cours envisagera notre rapport à la Bible hébraïque, entre religion et science.
Le récit biblique, et l'épisode le plus partagé d'entre eux : l'Exode, n'a pas fini de passionner les archéologues dans le monde entier et ce depuis un siècle et demi.
Comment la science naissante de l'archéologie s'est positionnée dans la seconde moitié du XIXème siècle face à la Bible ? Comment l'archéologie biblique s'est développée au point de devenir une discipline venant confirmer l'historicité du récit biblique ?
Comment au cours des décennies s'est inversée cette relation, au point de faire de l'archéologie la science infirmant la dimension historique de la Bible ?
Ce cours portera donc sur les relations, parfois tendues mais toujours passionnées, entre récit biblique et recherches archéologiques du XIXème au XXIème siècle, se divisant en 6 séquences :
1) Première moitié du XIXème siècle (1799-1860) : Le temps des pionniers
2) Seconde moitié du XIXème siècle (1860-1917) : Les débuts du dialogue entre Bible et la science naissante de l'archéologie
3) Première moitié du XXème siècle (1917-1948) : L'âge d'or de l'archéologie biblique
4) Milieu du XXème siècle (1948-1970) : L'archéologie biblique et l'état d'Israël
5) La seconde moitié du XXème siècle (1970-2000) : La mise au ban de l'archéologie biblique
6) Le XXIème siècle : L'archéologie biblique historique. La mise en place d'un nouveau dialogue…
.
Format du cours
Le MOOC est composé de 6 leçons. Chaque leçon est composé de six séquences vidéos.
Pendant la durée du cours, les apprenants sont
encouragés à échanger sur des forums de discussions animés par l’équipe
pédagogique.
Deux heures de travail personnel seront souhaitées
chaque semaine.
Les ressources du cours sont composées de courtes
séquences vidéos (environ une heures par semaine), de ressources
d’accompagnement (images, textes de référence, graphiques et
illustrations, bibliographies) et d'activités pédagogiques variées.
L'enseignant
Michaël Jasmin
- Docteur en archéologie orientale de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
- Rattaché aux équipes du CNRS : "Orient & Méditerranée" - UMR
81.67 et "Du Village à l'Etat au Proche et Moyen-Orient" - UMR
70.41
- Co-directeur de la Mission Archéologique de Tel d'Achziv,
Israël.
Plan du cours
SEMAINE 1
Leçon 1. Première moitié du XIXème siècle (1799-1860) : Le temps des pionniers
- L'objet du MOOC
- Avant l'archéologie scientifique : XVIIIe siècle
- Les premiers explorateurs : 1801-1817
- La première “fouille” : 1809
- Arpenter – cartographier : 1838, 1852
- Premières fouilles au Proche-Orient : 1843-44s
- Activités pédagogiques
- Discussions
SEMAINE 2
Leçon 2. Seconde moitié du XIXème siècle (1860-1917) : Les débuts du dialogue entre la Bible et la science naissante de l'archéologie
- Louis-Félicien de Saulcy et Heinrich Schliemann : 1863, 1870
- Le Palestine Exploration Fund (PEF), Londres : 1865
- Charles Wilson, Charles Warren à Jérusalem : 1867-1870
- Sir Flinders Petrie : comment dater les niveaux archéologiques ?
- Les fouilles au début du XXème siècle : 1894-1914
- Prospections dans le Néguev : 1914
- Activités pédagogiques
- Discussions
SEMAINE 3
Leçon 3. Première moitié du XXème siècle (1917-1948) :
L'âge d'or de l'archéologie biblique
- Archéologie et politique en période mandataire
- Les grandes découvertes archéologiques
- Développement institutionnel de l'archéologie
- Les institutions archéologiques juives (1914-1948)
- William Foxwell Albright (1891-1971)
- Nelson Glueck (1900-1971)
- Activités pédagogiques
- Discussions
SEMAINE 4
Leçon 4. Milieu du XXème siècle (1948-1970) :
L'archéologie biblique et l'État d'Israël
- L’État d'Israël et la déclaration d'indépendance
- Jéricho de J. Garstang à K. Kenyon (1952-1958)
- L'hébraicisation de la carte d'Israël (1949-1960)
- Yadin et les fouilles de Hazor (1952-1958)
- Yadin et les fouilles de Megiddo (1960-1971)
- Yadin et les fouilles de Massada (1963-1965)
- Activités pédagogiques
- Discussions
SEMAINE 5
Leçon 5. Fin du XXème siècle (1970-2000) :
La mise au ban de l'archéologie biblique
- William G. Dever et la New Archaeology
- La conquête de nouveaux territoires par Israël
- Israel Finkelstein et les prospections en Samarie
- Les « minimalistes » contre les « maximalistes »
- Israel Finkelstien et l'école archéologique de Tel Aviv
- Israël, la Bible et l'archéologie : vers un nouveau rééquilibrage ?
- Activités pédagogiques
- Discussions
SEMAINE 6
Leçon 6. Le XXIème siècle (2000 - 2020) :
“L'archéologie biblique historique”, un nouveau dialogue se met en place
- De nouveaux programmes de fouilles en Israël et Jordanie
- Une nouvelle approche voit le jour en 2005-2010
- Cas n°1 : L'orientation des maisons israélites à l'âge du Fer
- Cas n°2 : Les « maisons à quatre pièces » israélites
- Périodes du Mandat Britannique (1917-1948) et
israélo-jordanienne (1948-1967)
- Sur les relations entre l'archéologie et la Bible
- Activités pédagogiques
- Discussions
- Quizz hebdomadaire
À qui s'adresse ce cours ?
Ce Mooc est destiné à répondre à toutes les personnes
intéressées par l'histoire de l'archéologie et de la Bible.
Il peut permettre différents niveaux de suivi :
- La simple consultation des vidéos du cours,
- L'approfondissement du cours par des activités pédagogiques
intégrées, et des questions à discuter via les forums,
- La réponse régulière aux quizz,
- L'évaluation finale.
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ce
cours.
Le cours est en français.
Évaluation et attestation de suivi
A la fin de chaque semaine, des QCM autocorrectifs vous
permettront de faire le point sur vos acquis.
Au terme des six semaines de ce MOOC, une
évaluation finale vous sera proposée.
Une attestation de suivi avec succès est
attribuée par l'UNEEJ aux apprenants réussissant à obtenir une note
supérieure à 50 % aux quizz d’évaluation.
Réseaux sociaux
Retrouvez toutes les discussions autour du MOOC avec
le hashtag
#MOOCARCHEOLOGIE
Conditions d'utilisation
- du cours :
Licence restrictive : l’utilisateur ne peut exploiter l’œuvre qu’à des
fins personnelles et doit mentionner le nom de l’auteur.
- du contenu produit par les internautes :
Licence restrictive : votre production relève de votre propriété
intellectuelle et ne peut donc pas être réutilisée.